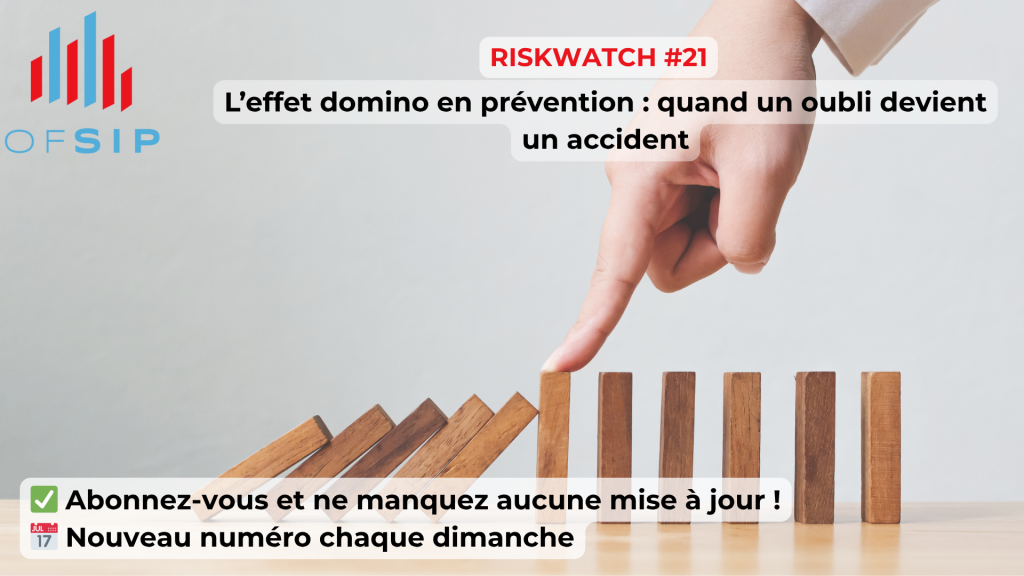
Dans la prévention des risques professionnels, on cherche souvent le point de rupture. Le moment précis où l’accident s’est produit, la cause directe, le geste mal exécuté. Mais ce serait une erreur de s’arrêter là. La réalité du terrain est bien plus complexe : les accidents sont rarement le fruit du hasard, et encore moins d’une seule cause. Très souvent, ils sont la conséquence d’une série de petits manquements, banals en apparence, mais redoutables une fois accumulés. C’est ce qu’on appelle l’effet domino.
Un oubli, puis un autre… et tout bascule
Il suffit de se rendre sur un site logistique, un chantier ou même dans un simple bureau pour s’en rendre compte. Un extincteur déplacé et non remis en place. Une alarme désactivée pendant des travaux, mais jamais réenclenchée. Une issue de secours encombrée par du mobilier “juste pour la journée”. Rien d’alarmant sur le moment. Sauf que si, ce jour-là, un départ de feu survient, tous ces petits oublis se transforment en obstacles majeurs à la survie.
Dans l’analyse d’accidents du travail, on retrouve souvent cette séquence de causes imbriquées. C’est rarement une seule erreur qui provoque l’accident, mais un enchaînement de négligences, de non-dits, de procédures mal respectées ou non actualisées. Et c’est là que la prévention prend tout son sens : anticiper ces scénarios, avant qu’ils ne deviennent réels.
L’effet domino, un mécanisme bien connu… et trop souvent ignoré
Le concept n’est pas nouveau. Il est largement utilisé dans les méthodes d’analyse des accidents, comme l’arbre des causes, ou le modèle de Reason et ses fameuses “tranches de fromage suisse” (chaque faille traversée par une erreur ou un dysfonctionnement). Mais dans la pratique, cet effet domino reste sous-estimé dans les politiques de prévention, car trop diffus, trop invisible… jusqu’au jour où l’un des dominos tombe.
Et quand il tombe, il entraîne les autres. Pas toujours au sens physique, mais en cascade organisationnelle, humaine, réglementaire. L’arrêt d’un poste, une enquête ITM, une atteinte à la réputation, un coût humain et financier. Et parfois bien plus grave.
Ce que disent les chiffres
- Selon Eurostat, en 2022, 27,4 % des accidents mortels au travail dans l’UEétaient liés à une perte de contrôle d’une machine, d’un outil ou d’un équipement de manutention, suivi de glissades, chutes ou efforts physiques
- Une source spécialisée (YouFactors) indique que 80–90 % des accidents sont liés à une erreur humaine, ce qui suggère souvent la stratégie ou comportement—mais cette statistique est globalement généralisée, sans découpage par secteur spécifique ou pays
- L’analyse d’accidents dans plusieurs pays d’Europe centrale (République tchèque, Slovaquie) identifie les principales causes comme des évaluations de risque insuffisantes et des pratiques de travail dangereuses, montrant que la multicausalité est une réalité, même si elle n’est pas chiffrée précisément
Pourquoi l’entreprise ne peut pas se contenter du strict minimum
Mettre en place un DUERP, désigner un travailleur sécurité, coller des affiches… ce n’est pas suffisant. La conformité réglementaire, aussi indispensable soit-elle, n’est que la base. Ce qui compte, c’est la vigilance collective. Le bon sens appliqué. L’analyse régulière des signaux faibles. Les “presque-accidents”, ceux qui n’ont pas fait de blessés, mais auraient pu. C’est là que se niche la vraie prévention.
Et surtout, la capacité à faire parler les situations, à remonter les petites anomalies sans les minimiser. Parce que souvent, l’accident qui arrive demain, on en a déjà vu l’ombre hier. Mais on n’a pas voulu ou su la regarder en face.
Comment casser la chaîne des dominos
Alors, que faire ? D’abord, changer de culture. Sortir du réflexe “tant que rien ne s’est passé, c’est que tout va bien”. Ensuite, se doter d’outils simples mais efficaces : revues de terrain régulières, entretiens sécurité, boîtes à idées, DUERP vivant, mises en situation, retours d’expérience. Et surtout, inclure tout le monde dans la démarche, pas seulement les préventeurs.
Le rôle du manager est essentiel, évidemment. Mais le collègue qui ose dire “ça, c’est dangereux”, celui qui range l’extincteur après utilisation, celle qui signale une fuite ou un obstacle, eux aussi sont les maillons forts de la chaîne.
Une responsabilité collective, un réflexe vital
À l’heure où les entreprises veulent tout optimiser, gagner du temps, réduire les coûts, la prévention reste l’un des rares domaines où chaque raccourci peut coûter très cher. L’effet domino nous rappelle que le moindre écart, même infime, a le pouvoir de tout déséquilibrer. Ce n’est pas une question de procédure. C’est une question de culture.
Et cette culture, elle se construit chaque jour, sur le terrain. Par des gestes, des regards, des réflexes. Et par la conviction, partagée, que la sécurité n’est pas l’affaire d’un seul, mais de tous.

