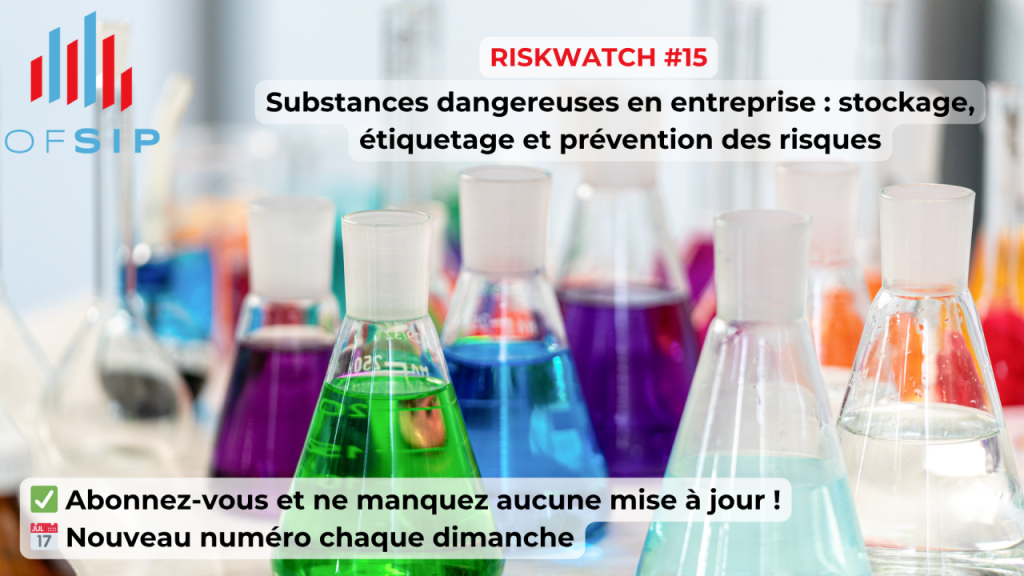
Dans la majorité des entreprises, on croise des produits dangereux sans même y prêter attention : solvants pour l’entretien, aérosols de nettoyage, produits de traitement, encres, peintures, huiles, détergents… Pourtant, ces substances, parfois banales en apparence, peuvent représenter un risque majeur pour la santé, la sécurité, et même l’environnement, si elles sont mal utilisées, stockées ou identifiées.
Et au Luxembourg, comme ailleurs en Europe, la réglementation est stricte. Mieux vaut prévenir que payer les conséquences… qui peuvent être lourdes.
De quoi parle-t-on ? Une définition claire
Une substance ou un mélange est considéré comme dangereux s’il présente au moins une des propriétés suivantes : inflammable, toxique, corrosif, cancérigène, mutagène, nocif pour l’environnement, explosif ou encore comburant.
Ces propriétés sont définies par le règlement européen CLP n°1272/2008, transposé intégralement au Luxembourg. Le CLP encadre la Classification, l’Étiquetage et l’Emballage des substances chimiques.
-> Exemple concret : Un simple dissolvant contenant de l’acétone est à la fois inflammable, irritant, et dangereux par inhalation. Sans étiquette lisible ou stockage approprié, le risque est immédiat, surtout en présence de chaleur ou d’une source électrique.
Le stockage : plus qu’une question d’étagère
Le stockage des produits dangereux répond à des règles précises :
- Séparation des familles incompatibles : acides vs bases, oxydants vs combustibles, etc.
- Ventilation suffisante : les vapeurs de solvants doivent être évacuées (risque d’explosion ou d’intoxication).
- Sols étanches et bacs de rétention pour prévenir les fuites.
- Accès contrôlé, réservé au personnel formé.
- Signalisation claire : indication de la nature du danger (pictogrammes CLP), consignes de sécurité, plans de secours.
📌 Au Luxembourg, ces obligations relèvent notamment du Code du travail, de la directive européenne SEVESO (pour les sites à risque), et des prescriptions de l’ITM (Inspection du Travail et des Mines).
L’étiquetage : votre premier rempart contre l’accident
L’étiquetage des produits chimiques doit impérativement respecter le règlement CLP :
- Nom du produit et composition ;
- Pictogrammes de danger (SGH) ;
- Mentions de danger (H) et conseils de prudence (P) ;
- Coordonnées du fabricant ou fournisseur ;
- Date de péremption si applicable.
Un produit sans étiquette lisible est un danger potentiel immédiat. L’étiquetage doit être maintenu même sur les produits transvasés dans un récipient secondaire.
Quels sont les risques pour la santé et la sécurité ?
Ils sont multiples :
- Inhalation de vapeurs toxiques : maux de tête, vertiges, atteintes pulmonaires.
- Contact cutané : brûlures, allergies, eczéma de contact.
- Explosions ou incendies en cas de mauvaise manipulation.
- Pollution de l’environnement par déversement accidentel.
📊 Statistique : d’après l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 17 % des maladies professionnelles déclarées en Europe sont liées à l’exposition aux substances chimiques. Au Luxembourg, l’AAA enregistre chaque année plusieurs dizaines d’accidents liés à des produits mal manipulés ou stockés.
Qui est responsable ?
C’est l’employeur, sans équivoque. L’article L.312-1 du Code du travail impose aux employeurs d’identifier tous les risques, de mettre en œuvre des mesures de prévention et de former les salariés.
Cela inclut :
- Une fiche de sécurité (FDS) accessible pour chaque produit ;
- Une évaluation des risques chimiques intégrée au Document Unique (DUER) ;
- La mise à disposition d’EPI adaptés (gants, lunettes, masques, etc.) ;
- Et une formation pratique à la manipulation et au stockage des substances.
Les obligations spécifiques pour certaines entreprises
Certaines activités (peinture industrielle, mécanique, nettoyage, coiffure, etc.) exposent davantage au risque chimique. Les employeurs doivent alors aller plus loin :
- Suivi médical renforcé pour les salariés exposés ;
- Contrôle atmosphérique régulier ;
- Déclaration de certaines substances à l’ILNAS ou à l’Administration de l’environnement.
Prévenir intelligemment : les bonnes pratiques
- Centralisez les produits dans des locaux adaptés et distincts ;
- Créez une base de données interne des FDS et produits utilisés ;
- Formez les salariés avec des exemples concrets (exercices, simulations) ;
- Mettez en place des plans d’urgence en cas de déversement ou d’incendie ;
- Réalisez un audit annuel avec un conseiller en sécurité externe.
Et après ? L’importance de la traçabilité et du suivi
Chaque produit doit faire l’objet d’un suivi dans le temps :
- Date d’achat ;
- Durée de vie ;
- Conditions de conservation ;
- Historique des incidents ou signalements.
Un logiciel de gestion des stocks chimiques peut être un vrai plus pour anticiper les ruptures, éviter les surstocks ou repérer les produits périmés.

