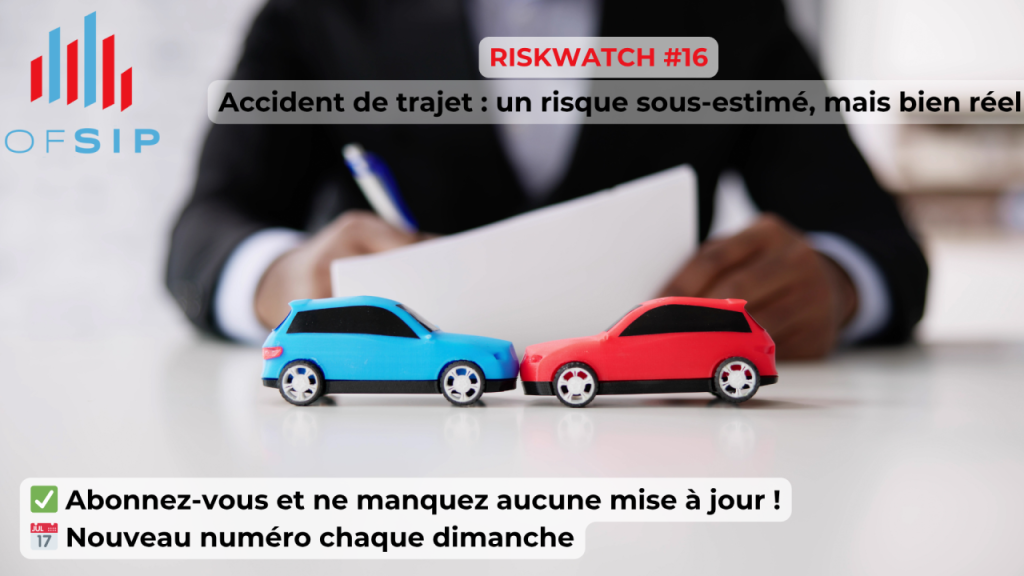
Chaque jour, des milliers de salariés luxembourgeois prennent la route pour rejoindre leur lieu de travail. Voiture, bus, vélo, trottinette, ou même à pied : tous ces trajets ont un point commun souvent ignoré, ils sont juridiquement et statistiquement reconnus comme une phase à risque, pouvant donner lieu à un accident de trajet. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Un constat préoccupant
Selon les données officielles de la AAA (Association d’Assurance Accident), le Luxembourg a enregistré 3 003 accidents de trajet en 2023. Ce chiffre représente près de 17 % du total des déclarations d’accidents professionnels (17 409 incidents au total, dont 14 273 liés à l’activité de travail elle-même).
Ce que ces statistiques révèlent, c’est que le risque ne commence pas à la porte de l’entreprise, mais bien avant. Et trop souvent, on l’oublie. Or, dans les faits, un accident survenu en se rendant ou en repartant du travail peut avoir des conséquences aussi lourdes qu’un accident sur site, pour le salarié, pour l’entreprise, et pour la collectivité.
Définition juridique et reconnaissance
Au Luxembourg, l’accident de trajet est pleinement reconnu par l’Association d’Assurance Accident (AAA) comme une sous-catégorie des accidents professionnels. Il s’agit d’un accident survenu pendant le trajet normal entre le domicile principal ou secondaire du salarié et son lieu de travail, que ce soit à l’aller ou au retour. Ce trajet peut également inclure les détours nécessaires et justifiés, comme le dépôt ou la récupération d’un enfant à l’école ou à la crèche, ou encore un passage par le restaurant d’entreprise pour les repas.
Pour être reconnu comme tel, le trajet doit être continu, direct, et accompli dans un laps de temps raisonnable. Toute interruption prolongée ou détour injustifié peut faire perdre la qualification d’accident de trajet.
À la différence de l’accident de travail (qui se produit sur le lieu ou dans le cadre direct de l’activité professionnelle), l’accident de trajet n’engage pas la responsabilité automatique de l’employeur. Néanmoins, il est assuré par le régime obligatoire d’assurance accident, à condition d’être déclaré dans les délais légaux, avec toutes les pièces justificatives demandées par la AAA.
En somme, le trajet entre le domicile (ou tout lieu assimilé) et le lieu de travail, à l’aller comme au retour, est protégé par le droit, dès lors qu’il est effectué dans des conditions normales.
Quels sont les facteurs de risque ?
Les causes d’accidents de trajet sont multiples et souvent bien connues : vitesse excessive, fatigue, distractions (smartphone), alcool, conditions météo, infrastructures mal adaptées… mais aussi, de plus en plus, stress, pression horaire, ou déficit d’aménagements pour les mobilités douces.
Par exemple, un salarié contraint de courir pour attraper son bus après une réunion qui a débordé, ou un autre qui roule vite pour déposer ses enfants à l’école avant l’embauche, se retrouve exposé à un risque bien réel, sans qu’il soit pour autant à son poste de travail.
Dans certains cas, le facteur humain est aggravé par des défaillances structurelles : routes non sécurisées, absence de pistes cyclables, manque d’éclairage, véhicules mal entretenus…
Des conséquences lourdes et coûteuses
Chaque accident de trajet coûte en moyenne plus de 4 300 € (selon le rapport AAA 2023), sans parler des pertes indirectes : arrêts maladie, remplacements temporaires, perte de productivité, démarches administratives.
Et dans les cas les plus graves, les conséquences humaines prennent le dessus : en 2023, 19 accidents mortels ont été recensés, tous types confondus, un rappel brutal que ces situations peuvent avoir un coût humain irréversible.
Quelles obligations pour les entreprises ?
Même si l’employeur n’est pas tenu responsable d’un accident de trajet dans la plupart des cas, la prévention reste une démarche attendue par les autorités. L’ITM, via ses recommandations récentes, encourage les employeurs à :
- Sensibiliser les salariés aux risques de trajet dès l’accueil sécurité
- Intégrer la prévention du risque routier dans le Document Unique d’Évaluation des Risques(DUER)
- Proposer des aménagements favorables aux mobilités douces (abris vélo, indemnités kilométriques, horaires flexibles…)
- Offrir des formations sur la sécurité routière ou sur les gestes à adopter en cas d’accident.
Certaines entreprises vont plus loin en mettant à disposition des navettes, en favorisant le télétravail partiel ou en adaptant les horaires d’arrivée et de départ selon les pics de circulation.
Comment prévenir ce type d’accident ?
La prévention des accidents de trajet passe par une double responsabilité : celle du salarié, bien sûr, mais aussi celle de l’organisation, qui peut créer un cadre propice à une mobilité plus sûre.
Voici quelques leviers éprouvés :
- Encourager les trajets partagés ou moins exposés
- Éviter les réunions tôt le matin ou tard le soir pour réduire les pics de fatigue
- Améliorer la visibilité et la lisibilité des itinéraires pour les nouveaux arrivants
- Informer les collaborateurs sur leurs droits en cas d’accident de trajet.
Une entreprise qui prend en compte ce risque montre qu’elle se soucie réellement de la santé globale de ses salariés, et pas uniquement de celle entre les murs.
Un enjeu culturel, pas seulement logistique
Dans une société où les trajets domicile-travail sont parfois perçus comme une formalité ou un “temps mort”, changer les mentalités est essentiel. L’intégration du risque de trajet dans la politique de prévention est un marqueur de maturité managériale.
Les chiffres de 2023 montrent clairement que nous avons encore du chemin à faire. Mais ils rappellent surtout une chose simple : la sécurité au travail commence avant même d’arriver au travail.

