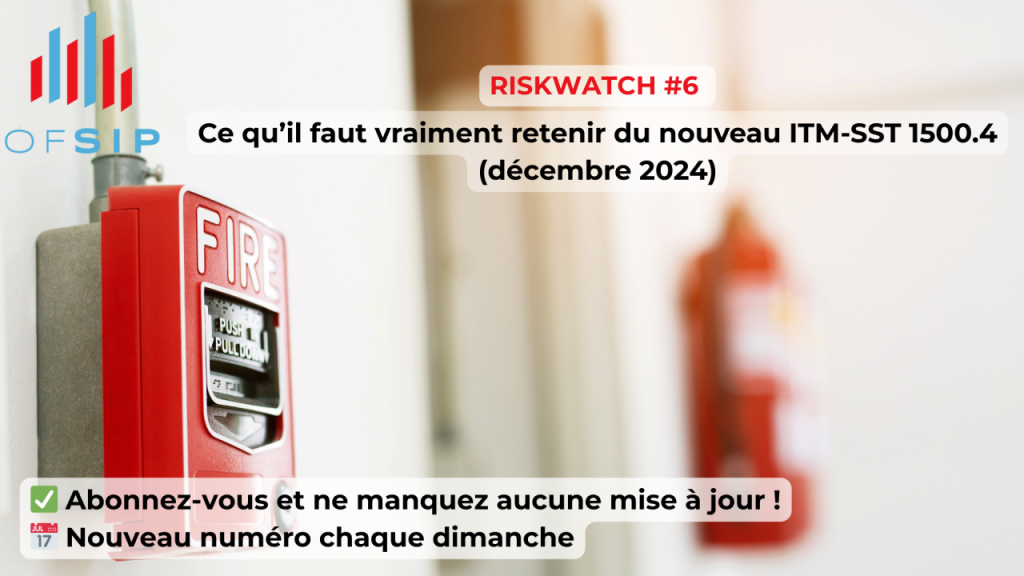
Le 19 décembre 2024, l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) ont publié la dernière mise à jour du ITM-SST 1500.4, document de référence pour la prévention incendieau Luxembourg.
Derrière ces ajustements techniques se cache en réalité une évolution stratégique : préparer les entreprises à des contrôles plus rigoureux, et surtout, limiter les drames en cas de sinistre.
Voici ce qu’il faut comprendre, concrètement, pour être à jour, en règle, et efficace sur le terrain.
1. Terminologie revue : parler le même langage que les secours
(Basé sur ITM-SST 1500.4 – Chapitre 2)
L’ITM a repensé la définition de nombreux termes-clés. Ce n’est pas anodin.
Quand les pompiers arrivent sur place, chaque seconde compte. Le fait que chemin d’accès, escalier d’évacuation à l’air libre, colonne sèche soient compris de la même manière par le chef d’intervention et par l’exploitant peut faire la différence entre un incident maîtrisé ou une catastrophe.
Exemples pratiques :
- Un chemin d’accès doit supporter le poids d’un camion de pompiers (~18 tonnes) et rester libre de tout obstacle. Un simple stationnement interdit devant peut retarder l’intervention de plusieurs minutes.
- Un escalier à l’air libre ne doit pas seulement « sembler » ouvert : il doit réellement permettre aux fumées de se dissiper naturellement pour éviter l’asphyxie des personnes en fuite.
📊 Chiffre clé : Selon le CGDIS, 40 % des interventions complexes sont ralenties par des erreurs de conception ou d’accès non conforme.
2. Voies d’évacuation : on ne laisse plus de place à l’improvisation
L’une des grandes clarifications du texte porte sur les voies d’évacuation :
- Les voies réglementaires doivent être protégées contre l’incendie pendant un temps donné (couloirs coupe-feu, portes résistantes au feu, désenfumage opérationnel).
- Les voies accessoires peuvent exister, mais elles n’exonèrent jamais des obligations sur les voies principales.
Exemples pratiques :
- Un entrepôt avec une seule sortie large ne sera plus considéré comme conforme s’il n’y a pas une voie alternative clairement identifiée.
- Un restaurant en sous-sol devra repenser ses issues pour garantir une évacuation rapide, même si la fréquentation est limitée.
📊 Données : Dans 70 % des incendies mortels survenus en ERP (Établissements Recevant du Public) en Europe entre 2018-2022, les mauvaises voies d’évacuation ont été un facteur aggravant majeur (European Safety Authority).
3. Moyens de secours : plus de précision pour mieux protéger
Le texte précise désormais mieux qui utilise quoi et dans quel contexte :
- Moyens de première intervention : pour le personnel (extincteurs, couvertures anti-feu).
- Moyens fixes automatiques : activation sans intervention humaine (sprinklers, brouillard d’eau…).
- Moyens pour pompiers : exclusivement pour les secours (colonnes sèches, bouches incendie).
Exemples concrets :
- Une salle informatique sensible devra privilégier un système de brouillard d’eau plutôt que des extincteurs classiques à poudre (pour éviter d’endommager les serveurs).
- Un bâtiment administratif > 4 étages devra intégrer une colonne sèche dans sa cage d’escalier.
📊 Rapport CGDIS 2023 : Dans 28 % des interventions, l’absence ou la mauvaise maintenance des moyens de secours installés a ralenti la progression des secours sur site.
4. Agents de sécurité incendie : pas que des « porteurs d’extincteurs »
Le texte ITM-SST 1500.4 introduit trois profils d’agents, avec des attentes claires :
- M1 : Agent de sécurité incendie dont l’objectif principal est la sécurité incendie de l’établissement
- M2: Agent non permanent de sécurité incendie, professionnel ou désigné par le personnel et dispensé à temps partiel à exécuter les tâche qui incombent à leur fonction.
- M3 : Agent non permanent de sécurité incendie désigné parmi le personnel de l’établissement et affecté à un étage ou un compartiment
Important :
- L’obligation porte sur la capacité réelle à agir, pas sur un diplôme spécifique.
- La formation peut être interne si elle est sérieuse et documentée.
📊 Fait intéressant : Une étude européenne indique que le taux de survie augmente de 45 % quand des agents formés interviennent dans les 2 premières minutes après le départ de feu (European Fire Response, 2022).
Plans d’évacuation : affichage, visibilité, accessibilité
L’ITM met l’accent sur l’importance des plans d’évacuation :
- Clarté absolue : pas de surcharge graphique, seulement l’essentiel (chemin, moyens de secours, rassemblement).
- Prise en compte des personnes en situation de handicap (parcours accessibles, ascenseurs d’évacuation spécifiques si permis).
- Mise à jour obligatoire en cas de travaux, déménagements ou évolutions structurelles.
📊 Étude BSI Group 2023 :
- 60 % des employés interrogés déclarent n’avoir jamais consulté les plans d’évacuation de leur entreprise.
- Sur les sites où le plan est simple, visible et affiché, ce taux chute à 20 %.
📚 Sources officielles
- ITM-SST 1500.4, édition 19 décembre 2024 (Inspection du Travail et des Mines / CGDIS)
- Code du Travail Luxembourgeois
- European Fire Safety Report 2022
- Rapport CGDIS 2023
- BSI Group – Workplace Safety Study 2023
En résumé
La version 2024 du ITM-SST 1500.4 est beaucoup plus qu’une mise à jour cosmétique. Elle fixe un nouveau standard d’exigence, où la clarté, la rigueur opérationnelle et l’anticipation deviennent indispensables.
Ne pas se préparer, ce n’est pas seulement prendre un risque réglementaire : C’est surtout s’exposer humainement.
Et comme toujours en prévention : ce qui est prévu sauve, ce qui est improvisé condamne.

