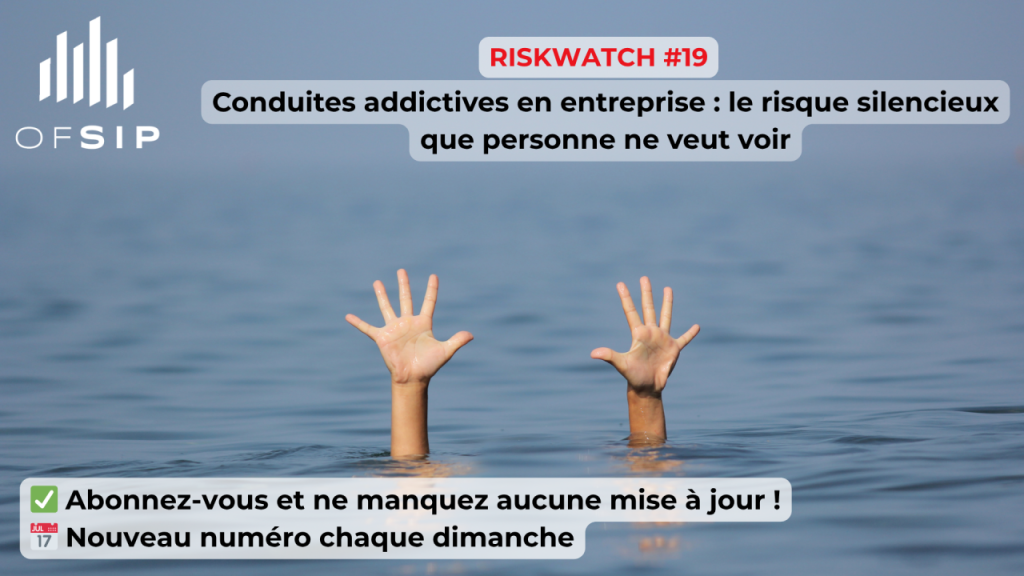
Il y a les risques évidents, visibles, bruyants. Et puis il y a ceux qui s’installent doucement, en silence, au creux des habitudes, dans l’ombre des bureaux, des ateliers ou des véhicules de service. Les conduites addictives en entreprise font partie de cette seconde catégorie. Trop souvent minimisées, parfois niées, elles n’en restent pas moins un enjeu majeur de santé, de sécurité… et de performance collective.
Un tabou qui persiste
Quand on parle de conduites addictives, l’image qui vient à l’esprit est encore trop souvent celle d’une bouteille d’alcool cachée dans un tiroir. Mais les réalités sont bien plus complexes aujourd’hui. L’addiction ne se limite plus à l’alcool : usage régulier de cannabis, médicaments psychotropes, cocaïne, mais aussi addictions comportementales comme le jeu d’argent en ligne ou les écrans, peuvent impacter directement la vigilance, la prise de décision, la sécurité… et parfois mettre en péril toute une équipe.
Le problème, c’est qu’on n’en parle pas. Par peur, par gêne, par méconnaissance. Et pourtant, les chiffres ne mentent pas. Selon une enquête menée par la Fondation Cancer Luxembourg, plus de 13 % des salariés reconnaissent avoir déjà consommé de l’alcool ou des substances psychoactives sur leur lieu de travail. Et ce chiffre grimpe à 20 % dans certains secteurs comme le bâtiment, le transport ou la logistique.
Un risque professionnel à part entière
Il est essentiel de comprendre que les conduites addictives ne relèvent pas uniquement de la sphère privée. Lorsqu’elles impactent la sécurité, la qualité du travail ou la relation aux autres, elles deviennent un risque professionnel à part entière, au même titre qu’un risque chimique ou un trouble musculosquelettique. À ce titre, elles doivent être intégrées dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), comme le prévoit la réglementation luxembourgeoise, notamment l’article L.312-1 du Code du travail.
Cette inscription formelle permet non seulement de légitimer les actions de prévention, mais aussi de structurer une démarche globale incluant la sensibilisation, la formation, l’alerte, l’accompagnement et, le cas échéant, la réorientation.
Repérer les signaux faibles… sans jouer au médecin
Il est toujours délicat d’identifier un comportement à risque sans tomber dans le jugement. Mais certains signaux doivent alerter : des absences répétées, des changements d’humeur, une baisse de performance soudaine, un isolement progressif, des tensions inhabituelles ou encore des erreurs fréquentes sur des tâches maîtrisées auparavant.
Les managers ne sont pas des psychologues, mais ils ont un rôle de proximité. Leur capacité à repérer ces signaux faibles peut faire toute la différence, à condition qu’ils soient formés, outillés, et soutenus par une politique RH cohérente.
Les obligations de l’employeur
Du point de vue légal, l’employeur a l’obligation de garantir la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation générale comprend aussi la mise en place d’un cadre permettant de prévenir, repérer et accompagner les conduites addictives. Cela passe par :
- Des actions de sensibilisation (affichages, campagnes internes, réunions d’équipe),
- La formation des encadrants,
- Un cadre clair pour le repérage et l’alerte, dans le respect de la confidentialité,
- La mise en relation avec des acteurs externes spécialisés, pour éviter toute improvisation.
Acteurs internes et relais externes
En interne, le travailleur désigné joue un rôle important, tout comme les RH, les délégués du personnel ou encore le médecin du travail lorsqu’il intervient. Mais il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur des ressources externes reconnues.
Au Luxembourg, plusieurs structures peuvent accompagner les entreprises :
- Centre National de Prévention des Addictions (CNAPA) : propose des programmes de prévention en entreprise.
- Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) ou tout autre service de santé au travail agréé : appui possible en sensibilisation ou conseil.
- Médecins du travail : rôle pivot dans la détection précoce et le suivi médical adapté.
Ces partenariats permettent de proposer un accompagnement professionnel, de sortir du cadre disciplinaire, et de repositionner l’approche sur la santé globale du salarié.
Prévention : une stratégie à construire
Il n’existe pas de solution miracle, mais une logique de prévention structurée, inscrite dans le temps. Cela commence par une charte claire, une politique interne définie, qui fixe les limites, les droits, les obligations de chacun. Il ne s’agit pas de surveiller, mais de protéger. D’accompagner sans juger. De proposer des solutions, pas des sanctions immédiates.
Certaines entreprises ont mis en place des « référents addictions », d’autres ont formalisé des « fiches réflexe » pour les managers. Ce sont des pistes. Mais ce qui compte vraiment, c’est la cohérence du message et sa régularité.
Et si on ne fait rien ?
Ignorer le sujet, c’est prendre un risque humain, organisationnel et juridique. Un salarié sous l’emprise d’un produit ou addict à un comportement à risque peut non seulement se mettre en danger, mais aussi mettre en péril la sécurité des autres.
En cas d’accident, la responsabilité de l’employeur peut être engagée, surtout si aucune démarche de prévention n’a été formalisée. La jurisprudence au Luxembourg, comme dans les pays voisins, rappelle que « l’absence d’action face à un risque connu » est un manquement grave.
Pour conclure : un enjeu de santé, pas de contrôle
Les conduites addictives ne sont pas une faiblesse morale. Ce sont des troubles du comportement qui nécessitent une prise en charge globale, humaine, bienveillante… mais structurée.
Traiter le sujet en entreprise, c’est éviter les drames, préserver la performance collective, et surtout, remettre l’humain au cœur du dispositif de sécurité. À condition d’oser en parler, et de mettre en place les bons relais.

